Eric Zemmour, Petit frère, Paris : Editions Denoël, 2008, réédition aux éditions J’ai lu, 2009
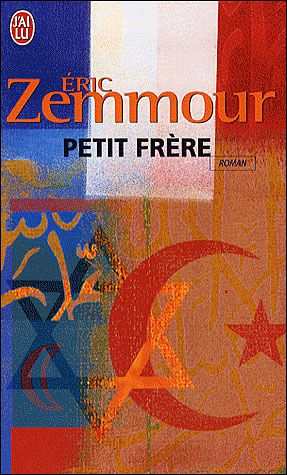
Il y a deux Zemmour. Le Zemmour analyste de la politique et le Zemmour analyste des faits sociaux. L’un et l’autre se cumulent, se complètent et se lient sans difficulté. On retrouve régulièrement les deux dans des émissions de télévision, sur i télé, sur France 4 et surtout dans l’émission de Laurent Ruquier On n’est pas couché le samedi sur France 2 assez tard dans la soirée. A force de le regarder tous les samedis, on finit par bien connaître ses idées. On les retrouve pleinement dans Petit frère. Mais cette fois, pas d’interruption par un invité, par Ruquier ou Nolleau, on dispose de Zemmour pour nous tout seul. Celui-ci prend son temps pour nous expliquer ses idées, celle des autres, ce qui va et ce qui ne va pas. Enfin surtout ce qui ne va pas. Mais plutôt que de le faire sous forme d’essai politique, Eric Zemmour a choisi la forme du roman. Elle paraît plus appropriée en effet pour décrire les petites choses du quotidien qui, avec le temps, font les grandes choses de la politique. Il ne s’agit donc pas d’une grande démonstration, mais d’une approche détournée. On saisit tout autant le message porté par l’auteur et vécu par le narrateur. Ce dernier ressemble à Zemmour mais il ne se présente pas officiellement. Il ressemble à l’auteur mais n’est pas l’auteur. Il est journaliste comme lui, mais ne dit pas vraiment ce qu’il pense à la télévision ; comme lui il est diplômé de Sciences Po mais contrairement à l’auteur il se dit de gauche et n’évolue que lentement vers une critique de son propre camp ; le narrateur est encore un héritier de Mai 68, un supporter des débuts de SOS Racisme, un combattant de l’antiracisme, un vilipendeur de la droite, cette fois plus rien à voir avec Zemmour. Mais ce narrateur, ami secret de politiciens de droite qui évoluent, eux, vers la gauche, réalise petit à petit ses erreurs de jeunesse. Tour à tour, et là Zemmour prend de plus en plus le dessus sur lui, il comprend être un idiot utile de la mondialisation. Il perçoit le communautarisme héritier du métissage qu’il a appelé de ses vœux, il voit s’entretuer ceux qu’il a forcé à vivre tandis que lui, privilégié de la classe d’intellectuel parisien bourgeois télévisé, se retranchait dans son appartement de Saint Germain des prés. En clair sur fond des violences et des problèmes sociaux des années 2000, Zemmour fait le procès des années 70 et 80 ; du passage du gauchisme à l’antiracisme, du transfert du regard des ouvriers (devenus des casseurs de grève, puis des frontistes) aux immigrés. C’est un premier message, récurrent dans les interventions publiques d’Eric Zemmour. On le découvre surtout, au cours du roman, à travers les débats du narrateur avec les amis de son milieu, des politiciens, de sa maîtresse, ou encore de celles de ses amis, etc.
Viennent ensuite plus précisément, à l’échelle quotidienne, la transformation de la vie des Français et l’intrusion progressive des conséquences de l’immigration massive et de l’échec de l’assimilation-intégration. Tous ces termes sont discutés d’une façon ou d’une autre par les faits ou dires des personnages, certains parlent plus qu’ils ne font — les journalistes, les politiques —, d’autres font (ou ne font pas, c’est parfois le problème) plus qu’ils ne parlent, leur niveau de français et d’éducation étant souvent bien faible — ce sont les habitants de la rue de la Grange-aux-Belles, entre Stalingrad et Colonel-Fabien, dans le XIXe arrondissement de Paris. Zemmour entre plus en détails dans les questions de relations entre populations immigrées d’Afrique noire ou d’Afrique du Nord : Arabes, Kabyles, juifs, noirs, musulmans, tous y passent. Le tableau n’est évidemment pas brillant. Sans s’intégrer réellement, encore moins assimilées, ces populations s’opposent, parfois s’affrontent, se côtoient mais se détestent. L’envie, la haine, la frustration, la domination, la conquête et le pouvoir sont les sentiments qui les régissent. Sur fonds de traditions orientales et de musique américaine, le trafic de drogue pullule, les gangs se créent, l’atmosphère de l’immeuble se détériore ; et sur le dos de l’antiracisme c’est en fait le racisme qui domine. « Trop d’Arabes », « Hitler n’a pas fini son travail » ou les noirs « Esclaves, fils d’esclaves » sont les discours tenus de tous côtés par les personnages. Personne n’y échappe vraiment, personne n’est vide de ces pensées, seule la réalité reste.
Plus en détails encore, le livre prend pour fil conducteur une histoire vraie, un fait divers comme on dit, l’assassinat d’un jeune juif par un jeune arabo-musulman. Bien que les noms aient été changés, on reconnaît bien entendu l’affaire Sellam, cette famille dont le fils DJ a été tué, dont le procès est encore en cours et auquel ce livre a fait écho il y a deux ans. Le tout est bien sûr transformé et romancé même si Zemmour entendait décrire un milieu précis. Il nous faut dire aussi notre incompréhension envers la réaction de la famille qui a fort mal réagi à la publication de ce livre. On peut comprendre certes qu’elle se sente lésée par une transformation des faits mais il faut prendre en compte, d’une part la volonté de transformation littéraire (c’est un roman pas un essai politique), d’autre part le fait que la famille Sitruk, la famille juive dans le livre, n’y jouit pas d’un si mauvais statut. Mises à part quelques phrases vindicatives, assez rares toutefois, prononcées à l’encontre des Arabes, qu’il faut aussi remettre dans le contexte d’une famille dont le fils est assassiné par un fou d’Allah, elle n’est pas si mal décrite. Bien sûr Zemmour n’a pas la langue dans sa poche en ce qui concerne les Juifs français qu’il met en scène et auxquels il ne fait pas de cadeaux. Ils les montrent en effet rêvant d’Amérique, sans considération pour la France qu’ils jugent perdue, finie, peureuse, soumise aux Arabes. Au lieu de la culture et de l’élitisme à la française qui motivèrent tant de leurs prédécesseurs coreligionnaires, ces juifs immigrés d’Afrique du Nord se réfugient dans l’argent, les Etats-Unis, Israël, et la religion de leurs pères. Au passage c’est l’une des rares fois où Zemmour, par l’intermédiaire de son narrateur, se met en scène comme juif. Mais c’est plus l’Israélite intégré, et qui se veut assimilé (lui !), qu’il incarne, ne témoignant que d’éloignement envers les autres juifs. Il avoue même (son personnage) un mariage avec une française de souche, à particules, qu’il voit comme le moyen d’assimilation par excellence. Petit Israélite, c’est la grande France qu’il épouse, plus que la femme, dont il divorce finalement. Mais Zemmour n’évite pas non plus la montée de l’islamisme, le racisme arabe envers les noirs « esclaves [aux] gros zob’s », les Kabyles et bien sûr les juifs, sans oublier les chrétiens, bref tous les mécréants. Ce racisme se matérialise aussi bien dans la tradition arabo-musulmane, que dans l’islamisme montant. Cela va du business des juifs — ‘toujours le succès pour les mêmes’ — aux appels aux meurtres envers ceux qui trahissent la parole de dieu. L’auteur accompagne aussi son texte de citations du Coran ou de Hadiths, particulièrement sanglantes et intolérantes. Il se permet aussi, par le biais d’un personnage ou d’un autre, de quelques remarques amusantes ou franchement intéressantes sur les racines d’une religion, l’essence d’un comportement, d’une mentalité et esquisse même une citation du Talmud. Bien que Zemmour, nous semble-t-il, ne soit pas un sage talmudiste, cette illustration talmudique de l’absurdité, de l’échec et des conséquences néfastes du multiculturalisme à la française et de l’antiracisme idéologique, nous paraît plutôt bien choisie.
 Enfin, sur le fond, puisque Zemmour aime souligner la diminution (voire l’écroulement), à son goût, du niveau littéraire (et scolaire), précisons clairement que Petit Frère n’est sans doute pas le roman du siècle. Sur le plan de l’observation des faits politiques et sociaux, il mérite, selon nous, qu’on lui accorde une grande attention, qu’on s’intéresse franchement à la dégradation dont il témoigne. Il ne s’agit pas non plus du meilleur livre de sociologie qui soit, mais c’est un bon livre. Sur le plan littéraire c’est un bon livre aussi mais pas exceptionnel. Zemmour use de quelques figures en alternant les différents plans, joue avec le temps et l’espace, et donne à son narrateur un vocabulaire plus soutenu que les individus incultes qu’il critique. On a toutefois parfois l’impression que c’est surfait. Comme si, tout d’un coup, Zemmour décidait de prouver son vocabulaire avec un mot qui sort de l’ordinaire, mais c’est seulement occasionnel. C’est peut être à force d’entendre le journaliste critiquer la pauvreté du vocabulaire des nouvelles générations que cette impression ressort, admettons-le, mais c’est ainsi que nous l’avons vu.
Enfin, sur le fond, puisque Zemmour aime souligner la diminution (voire l’écroulement), à son goût, du niveau littéraire (et scolaire), précisons clairement que Petit Frère n’est sans doute pas le roman du siècle. Sur le plan de l’observation des faits politiques et sociaux, il mérite, selon nous, qu’on lui accorde une grande attention, qu’on s’intéresse franchement à la dégradation dont il témoigne. Il ne s’agit pas non plus du meilleur livre de sociologie qui soit, mais c’est un bon livre. Sur le plan littéraire c’est un bon livre aussi mais pas exceptionnel. Zemmour use de quelques figures en alternant les différents plans, joue avec le temps et l’espace, et donne à son narrateur un vocabulaire plus soutenu que les individus incultes qu’il critique. On a toutefois parfois l’impression que c’est surfait. Comme si, tout d’un coup, Zemmour décidait de prouver son vocabulaire avec un mot qui sort de l’ordinaire, mais c’est seulement occasionnel. C’est peut être à force d’entendre le journaliste critiquer la pauvreté du vocabulaire des nouvelles générations que cette impression ressort, admettons-le, mais c’est ainsi que nous l’avons vu.
En fin de compte, comme son narrateur, Zemmour subit et en même temps profite de la télévision. Par son livre, comme par ses articles écrits (qui ont fait sa carrière avant la télévision précisons-le), il entend se détacher de son personnage télévisuel, mais celui-ci le retient un peu et après tout, c’est par lui qu’on a une meilleure connaissance de l’homme.




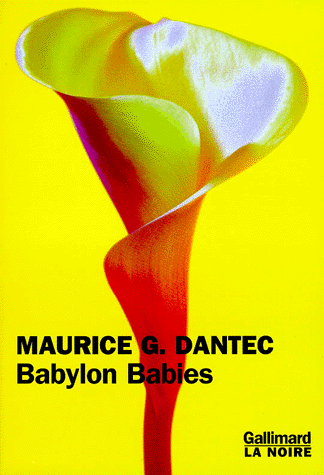


 A l’heure où le dernier essai de La Bible au féminin de Marek Halter, Marie
A l’heure où le dernier essai de La Bible au féminin de Marek Halter, Marie

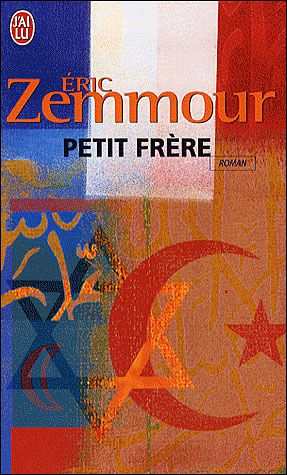
 Enfin, sur le fond, puisque Zemmour aime souligner la diminution (voire l’écroulement), à son goût, du niveau littéraire (et scolaire), précisons clairement que Petit Frère n’est sans doute pas le roman du siècle. Sur le plan de l’observation des faits politiques et sociaux, il mérite, selon nous, qu’on lui accorde une grande attention, qu’on s’intéresse franchement à la dégradation dont il témoigne. Il ne s’agit pas non plus du meilleur livre de sociologie qui soit, mais c’est un bon livre. Sur le plan littéraire c’est un bon livre aussi mais pas exceptionnel. Zemmour use de quelques figures en alternant les différents plans, joue avec le temps et l’espace, et donne à son narrateur un vocabulaire plus soutenu que les individus incultes qu’il critique. On a toutefois parfois l’impression que c’est surfait. Comme si, tout d’un coup, Zemmour décidait de prouver son vocabulaire avec un mot qui sort de l’ordinaire, mais c’est seulement occasionnel. C’est peut être à force d’entendre le journaliste critiquer la pauvreté du vocabulaire des nouvelles générations que cette impression ressort, admettons-le, mais c’est ainsi que nous l’avons vu.
Enfin, sur le fond, puisque Zemmour aime souligner la diminution (voire l’écroulement), à son goût, du niveau littéraire (et scolaire), précisons clairement que Petit Frère n’est sans doute pas le roman du siècle. Sur le plan de l’observation des faits politiques et sociaux, il mérite, selon nous, qu’on lui accorde une grande attention, qu’on s’intéresse franchement à la dégradation dont il témoigne. Il ne s’agit pas non plus du meilleur livre de sociologie qui soit, mais c’est un bon livre. Sur le plan littéraire c’est un bon livre aussi mais pas exceptionnel. Zemmour use de quelques figures en alternant les différents plans, joue avec le temps et l’espace, et donne à son narrateur un vocabulaire plus soutenu que les individus incultes qu’il critique. On a toutefois parfois l’impression que c’est surfait. Comme si, tout d’un coup, Zemmour décidait de prouver son vocabulaire avec un mot qui sort de l’ordinaire, mais c’est seulement occasionnel. C’est peut être à force d’entendre le journaliste critiquer la pauvreté du vocabulaire des nouvelles générations que cette impression ressort, admettons-le, mais c’est ainsi que nous l’avons vu. 


